450-350 ka : un seuil dans l’évolution humaine ? Comprendre les racines du monde néandertalien
Lien du projet : https://sites.google.com/unife.it/neanderoots/home
Porteurs du projet : Marie-Hélène Moncel
Source de financement : ANR (durée 2019-2022)
Membre impliqué à GEOPS : Alison Pereira
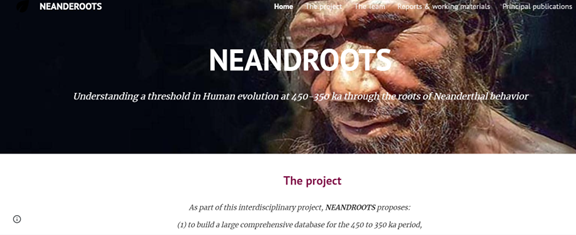
NEANDROOTS est un projet interdisciplinaire qui propose : (1) de réaliser une large base de données archéologiques entre 450 et 350 ka, (2) d’enrichir et uniformiser les données chronologiques des sites et les données environnementales, (3) de développer des approches méthodologiques afin d’identifier les traits régionaux et proposer des modèles de diffusion des innovations, (4) de modéliser le rôle de la taille et structure des populations, et (5) tester l’impact de l’évolution climatique sur l’adaptation humaine (modèles iLOVECLIM et ECNM). Cette contribution multidisciplinaire concerne une période clé de l’histoire humaine mal connue et a comme objectif de: (1) proposer des modèles des réponses humaines à de nouveaux (et variés) environnements basés sur la disparition et l’acquisition d’outillages et d’expertises, (2) comprendre les mécanismes de transmission culturelle au cours du temps et les processus avec lesquels les innovations et les inventions se développent et sont maintenues. L’objectif est de contribuer à comprendre le plus ancien cycle de régionalisation européen, bien antérieur à celui contemporain de la fin des Néandertaliens (MIS 4-3). Cette approche n’a jamais été appliquée pour le début du monde néandertalien. La réalisation d’une chronostratigraphie unifiée aidera à replacer dans le temps les nouveaux comportements, les avancées technologiques et les modifications anatomiques des hominidés dans leur cadre climatique et environnemental. La réalisation de cartes synthétiques à haute résolution permettra de corréler les données climatiques, environnementales et archéologiques. Cette analyse détaillée des interactions entre Humains et Environnements pourrait devenir un modèle pour comprendre des évolutions analogues, entre passé et présent. Enfin, nous questionnons la question de la résilience des sociétés face aux changements climatiques. L’étroite association entre les mécanismes physiques, les données climatiques et archéologiques repoussera les limites des méthodes utilisées à ce jour.
Ce projet interdisciplinaire implique sept équipes françaises, chacune avec des compétences complémentaires : MNHN, LSCE, EPOC/PACEA/Université de Bordeaux, IGE, LMD, LGP et Université de Lille. Un large réseau européen contribue également à ce projet, regroupant des préhistoriens, un anthropologue, des tracéologues et un spécialiste de la modélisation en paleodémographie.